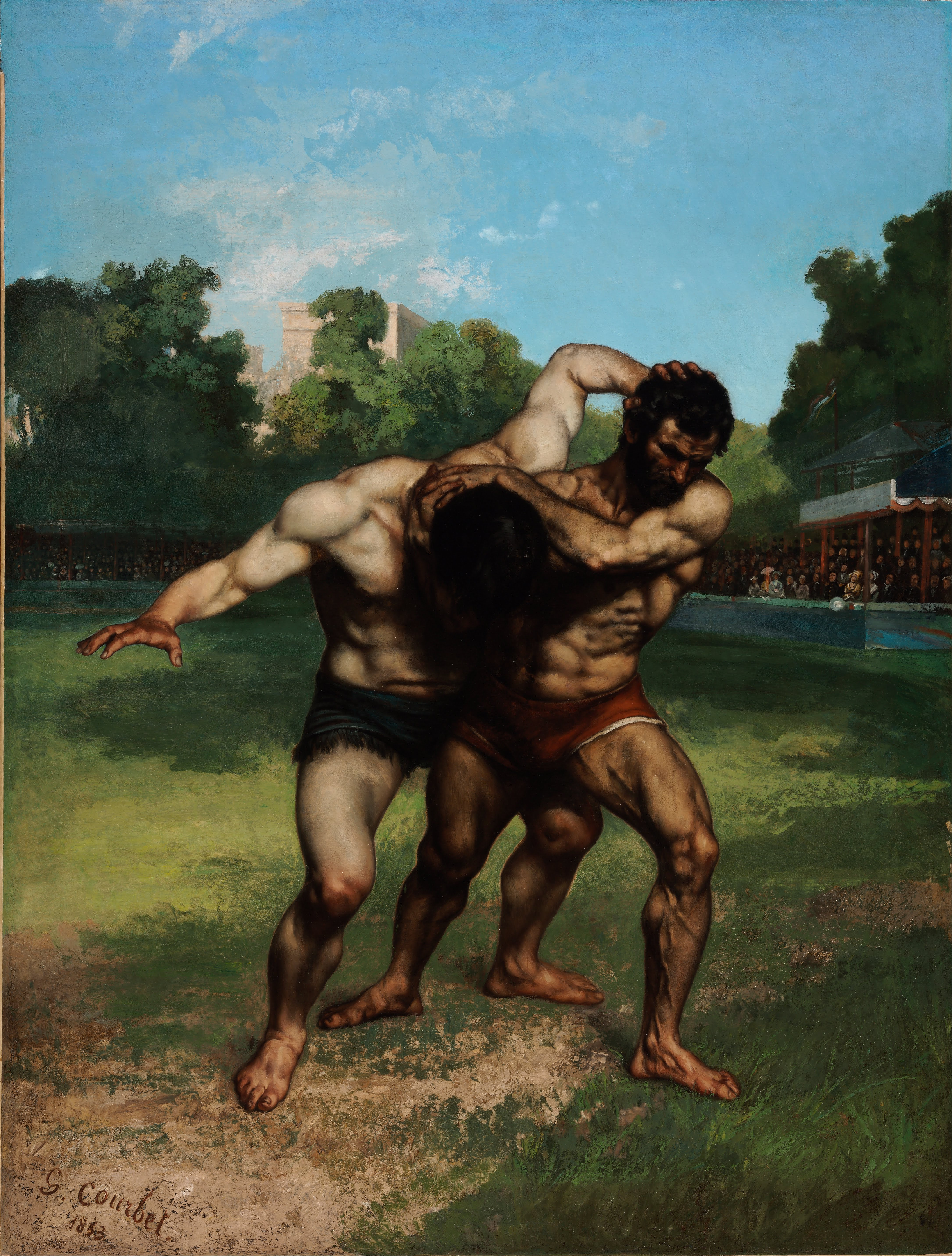Ce grand tableau, que Courbet présente au salon de 1853 avec Les lutteurs (Budapest, Szépmüvészeti muzeum) et La fileuse endormie, reprend le thème classique des baigneuses mais d’une manière si personnelle et provocatrice qu’il lui valut un scandale sans précédent.
En effet la baigneuse, qui a toujours représenté en peinture l’idéal féminin (Diane, Vénus ou Suzanne), est figurée par Courbet en bourgeoise plantureuse, les pieds sales, les bas avachis, sans fards.

Par ailleurs, la monumentalité du format, jusque-là réservée aux genres nobles, peinture d’histoire ou religieuse, en accentue l’aspect provocateur. La gestuelle affectée se révèle elle-même ambiguë, faisant dire à Delacroix : « la vulgarité des formes ne serait rien, c’est la vulgarité et l’inutilité de la pensée qui sont abominables... ».
En dépit de toutes ces critiques, Alfred Bruyas, avide de modernité, se fit un devoir d’acquérir ce tableau manifeste : « Voici l’art libre, cette toile m’appartient » aurait-il dit. Ce fut à cette occasion qu’il rencontra Courbet et que se noua l’amitié si féconde entre l’artiste et le mécène montpelliérain.

Les Baigneuses, 1853
Huile sur toile, 227 cm × 193 cm
868.1.19
Au-delà du scandale, les motivations de Courbet laissent encore place aux interprétations. Lui-même disait : « le tableau des Baigneuses représente une phase curieuse de ma vie, c’est l’ironie ».