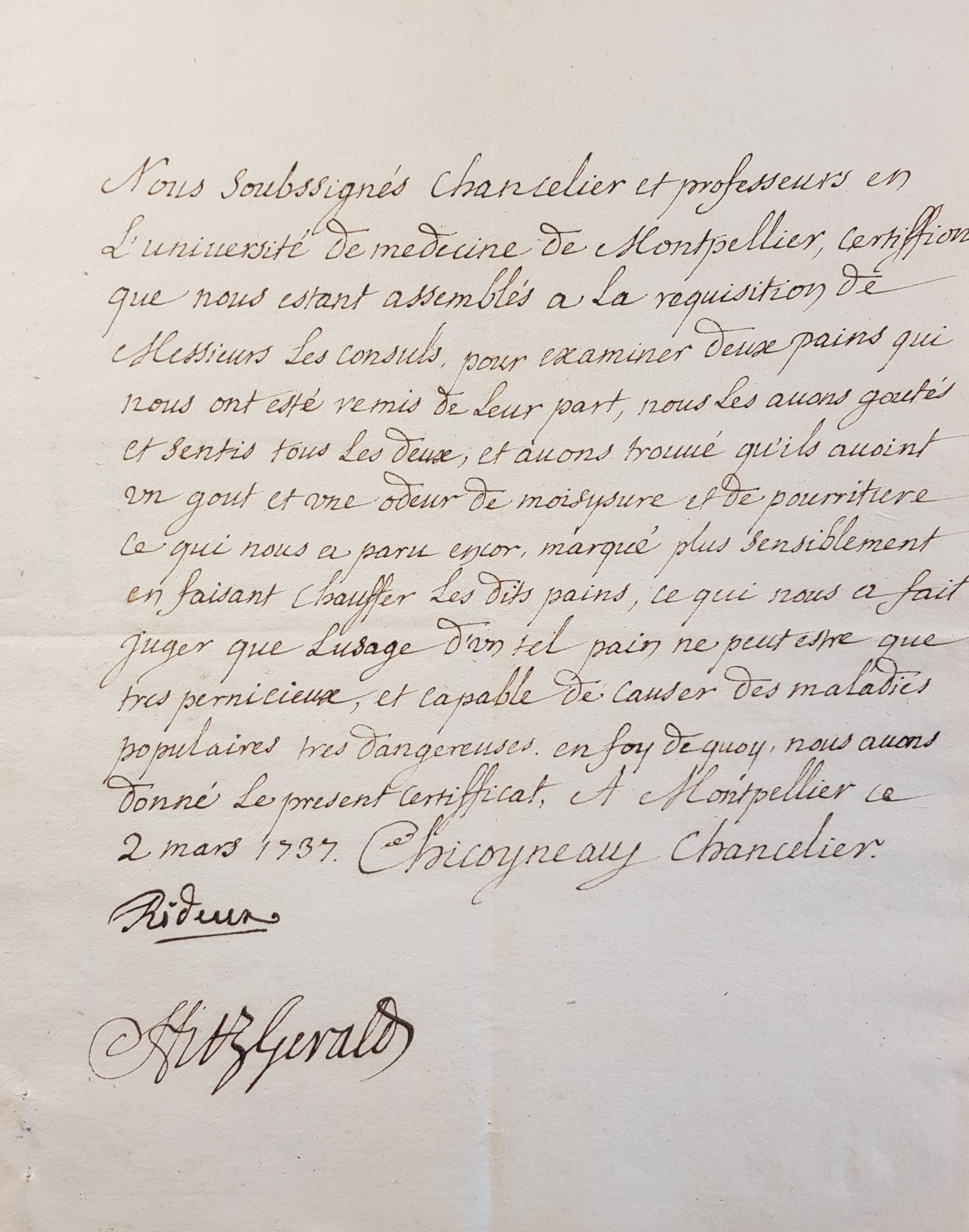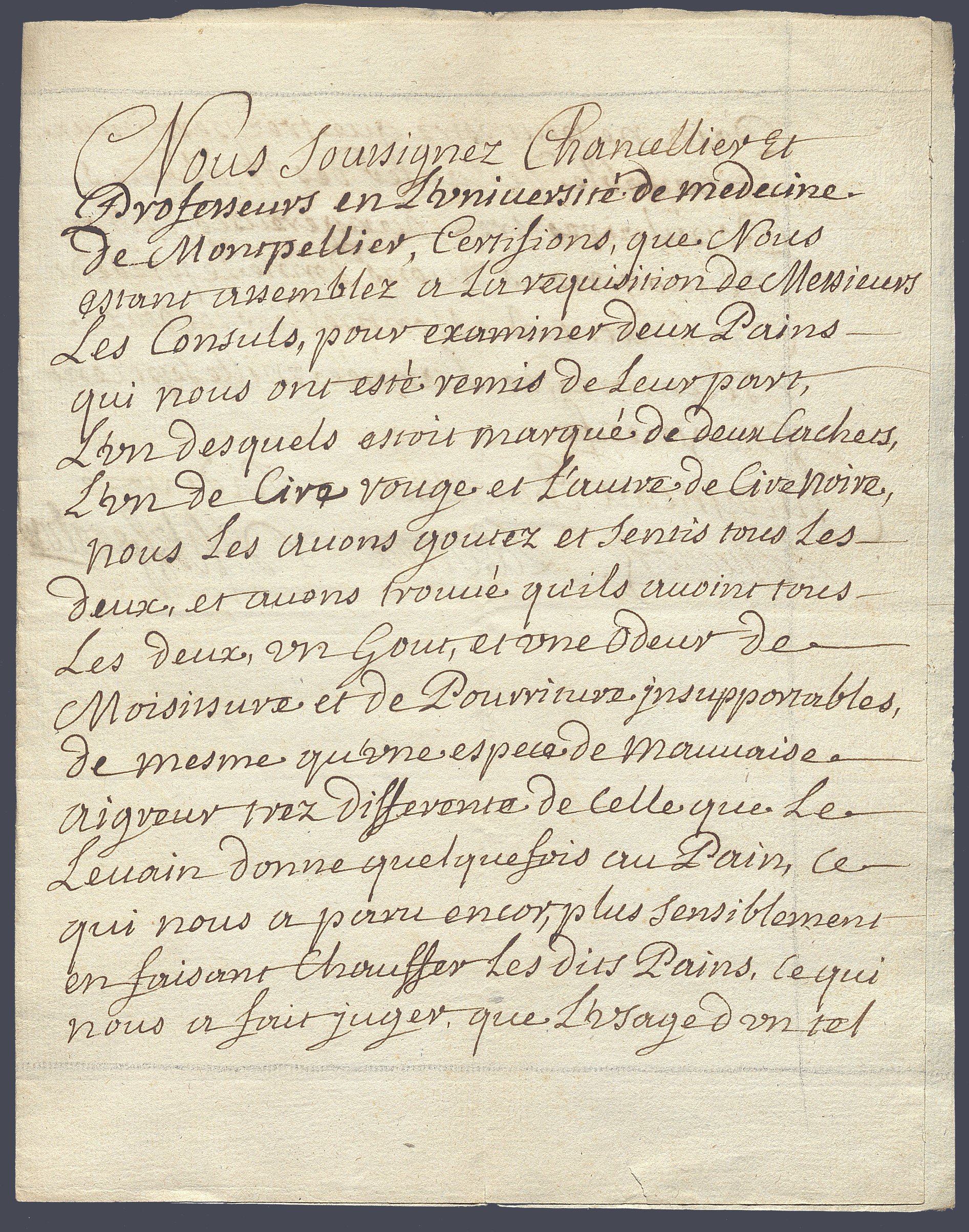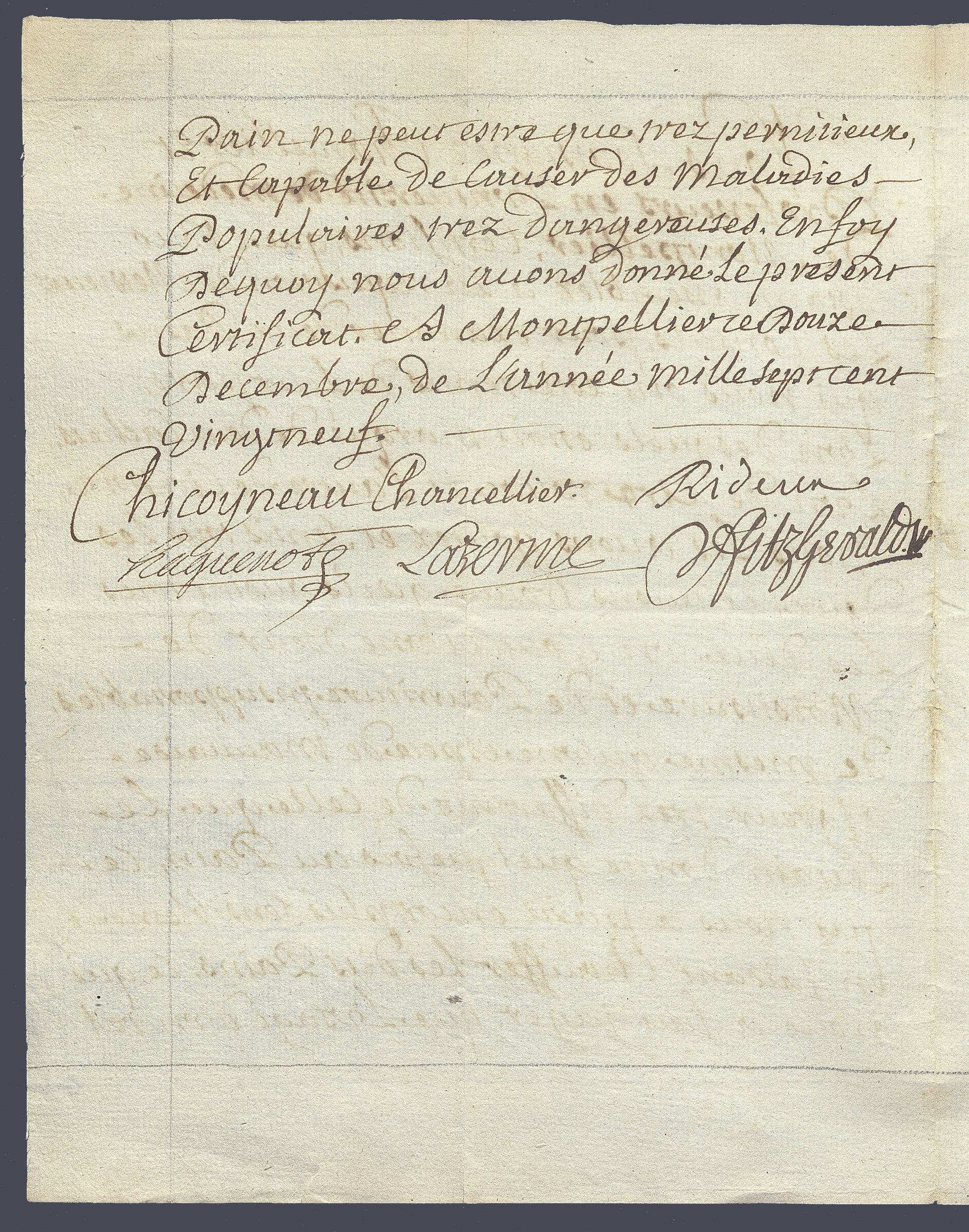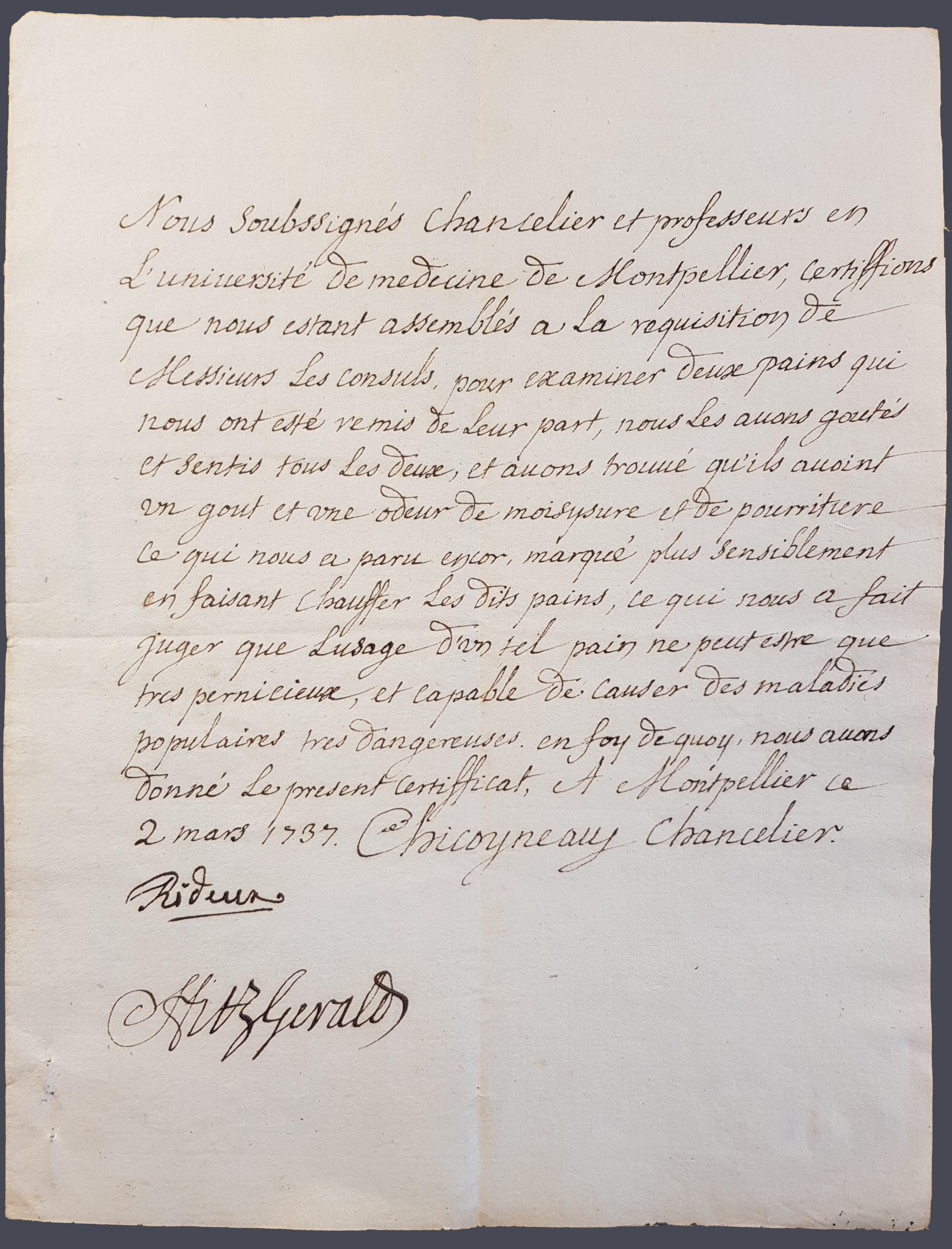Au siècle des Lumières, Montpellier est la ville la plus médicalisée du royaume, c’est-à-dire celle qui compte le plus de médecins et de chirurgiens par rapport à la taille de sa population. À la fin de l’Ancien Régime, la ville atteint les taux records de 14,3 médecins et 16,6 chirurgiens pour 10 000 habitants d’après les calculs de Pierre Goubert et Bernard Lepetit, soit trois fois plus que la moyenne des autres villes du royaume. La cité est le lieu d’exercice et de vie de nombreux médecins, chirurgiens et apothicaires. Au cours du XVIIIe siècle, le nombre de positions liées à la santé a augmenté, particulièrement le nombre de chirurgiens au nouveau Collège de chirurgie et à l’Hôtel-Dieu ou hôpital Saint-Éloi. À la fin du siècle, la ville devient également un lieu de villégiature médicale à destination d’une riche patientèle de touristes étrangers, souvent anglais, à l’image d’Anna Francesca Cradock.
Le champ médical montpelliérain des Lumières est dominé par deux institutions, l’Université de médecine et le Collège de chirurgie. Il est essentiellement composé de trois groupes de professions, les médecins et les corporations de chirurgiens et d’apothicaires. Par ailleurs, son réseau hospitalier est important comptant, d’après les travaux de Louis Dulieu, la maladrerie de Saint-Lazare (jusqu’en 1713), l’Hôtel-Dieu Saint-Éloi (depuis 1183), l’hôpital général (depuis 1678), les hôpitaux militaires Saint-Louis (1731-1787) puis de la Cavalerie (1787-1789) et l’hôpital réservé aux protestants (1785-1792) fondé par Madame Necker.
Montpellier dispose aussi de trois groupes professionnels différemment organisés. Les communautés d’apothicaires et de chirurgiens fonctionnent comme les autres corps professionnels d’Ancien Régime : formation des apprentis, production de normes, régulation des conflits, organisation de la vie collective, le tout inscrit dans les registres. Par contre, il n’y pas de communauté de médecins à proprement parler. Bien qu’absents des rares listes de médecins, les professeurs de l’Université sont aussi praticiens. C’est par exemple le cas des Haguenot ou de Barthez. Tout au long du siècle, en particulier dans les années 1740-1750, les tensions interprofessionnelles sont fortes, en particulier entre les médecins et les chirurgiens.
Le champ médical
L’Université et les médecins
Quoique cette Science très-nécessaire à la conservation du Genre humain fut cultivée dans cette Ville avant le douzième Siècle, ses Écoles n’y avoient pas encore pris une certaine forme. C’étoient différens Médecins établis dans cette Ville, qui, sans être réunis à un Corps, faisoient les Leçons aux Elèves que leur réputation attiroit parmi eux [...].
On remarquera qu’outre les huit Professeurs qui seuls forment le corps de cette Université, il y a dans cette Ville un grand nombre de Docteurs Médecins qui y exercent leur Art, mais qui ne sont point Membres de ladite Université.
Les maîtres apothicaires
Ce corps fut établi en 1630. Les Apot[h]icaires sont reçus maîtres par Messieurs les Chancelier & Professeurs de l’Université, qui assistent à tous leurs examens & chef d’œuvre. On leur donne la qualité de maître en la Faculté de médecine, ils font publiquement, chez eux, toutes les années, quatre compositions, de thériaque, confection d’hyacinthe, confection d’alkermes, & diascordium. Le Corps de l’Université de Médecine assiste pour examiner les drogues, & les Apot[h]icaires vont toutes les années à la Foire de Beaucaire pour y vendre ces quatre compositions, afin que le public en soit bien pourvu. Ces Messieurs ont des beaux Statuts dont on parlera l’année prochaine.
D’après Almanach de Montpellier, 1758, p. 94-98 et p. 130-131.
Comme dans d’autres villes du royaume à la fin du siècle des Lumières, “la présence d’universités ou de collèges de médecine semble déterminante pour expliquer les taux élevés de médicalisation” comme l’écrivent encore Pierre Goubert et Bernard Lepetit. Montpellier est assurément une importante cité médicale grâce à son université de médecine qui, plus encore que celle de Paris, attire de très nombreux étudiants au XVIIIe siècle. Elle polarise tout le Midi médical comme l’a montré Hélène Berlan dans son étude sérielle et cartographique de la population estudiantine de l’Université de médecine. Elle fabrique en particulier de très nombreux docteurs. Pour les médecins, le doctorat n’est pas obligatoire pour l’exercice professionnel dans le royaume mais il permet à son titulaire d’exercer avec un surcroît de prestige.