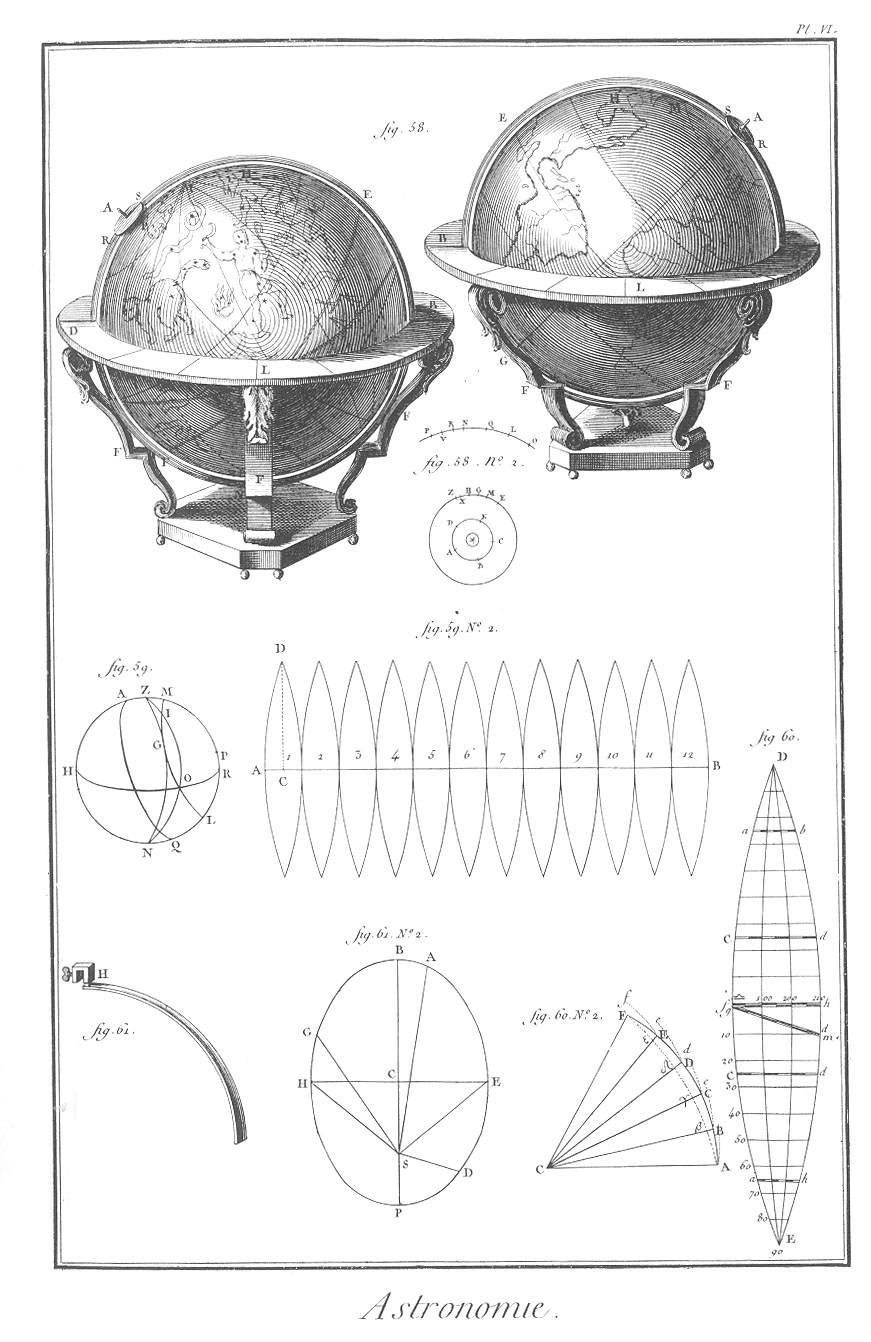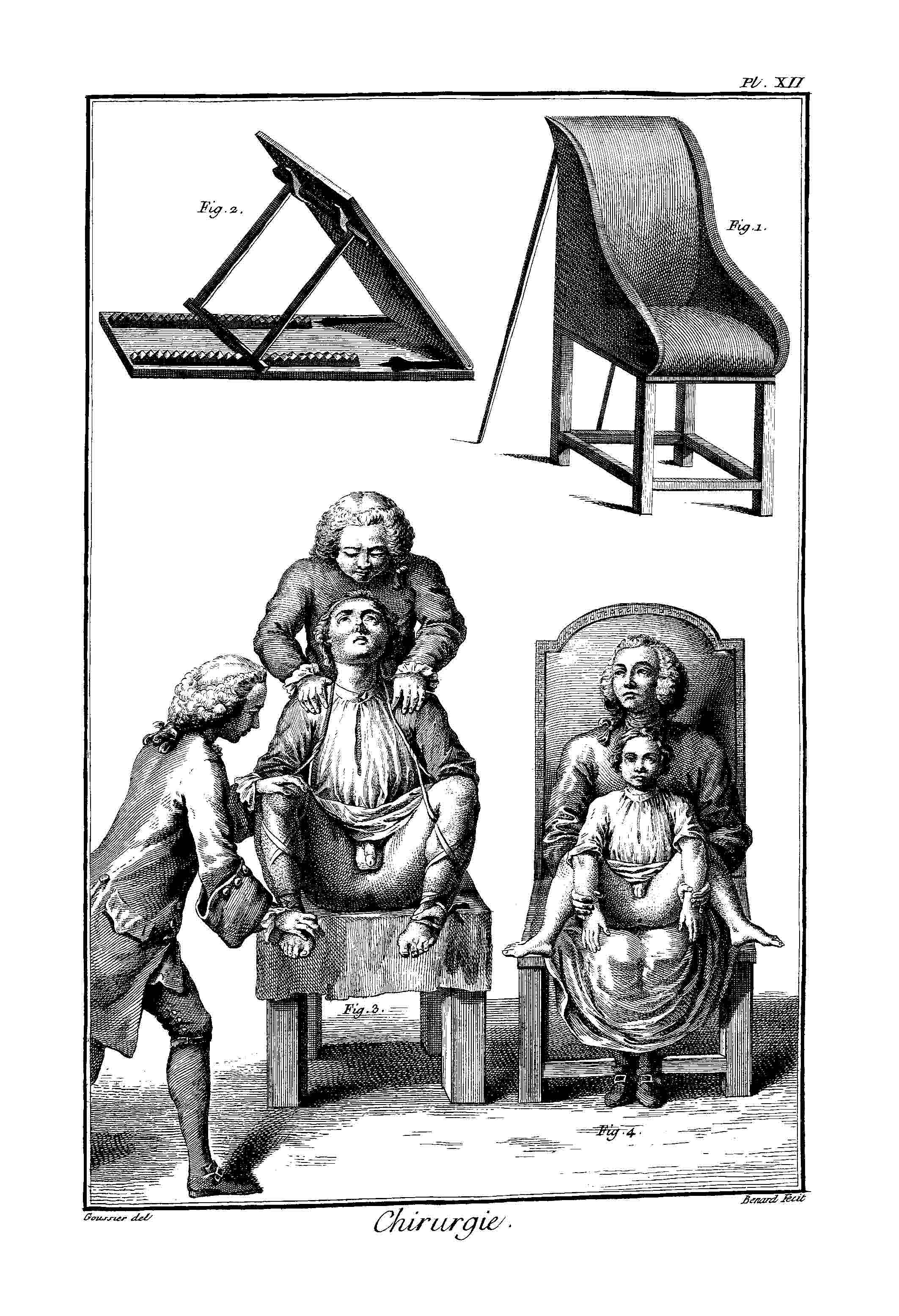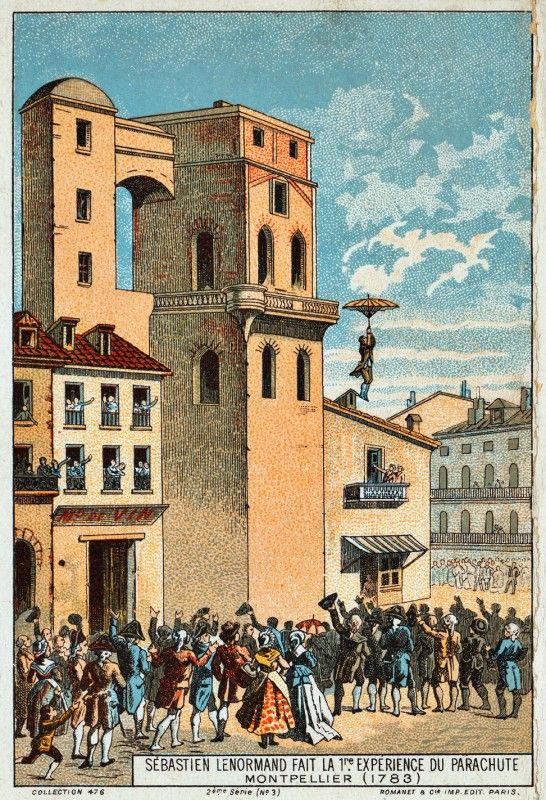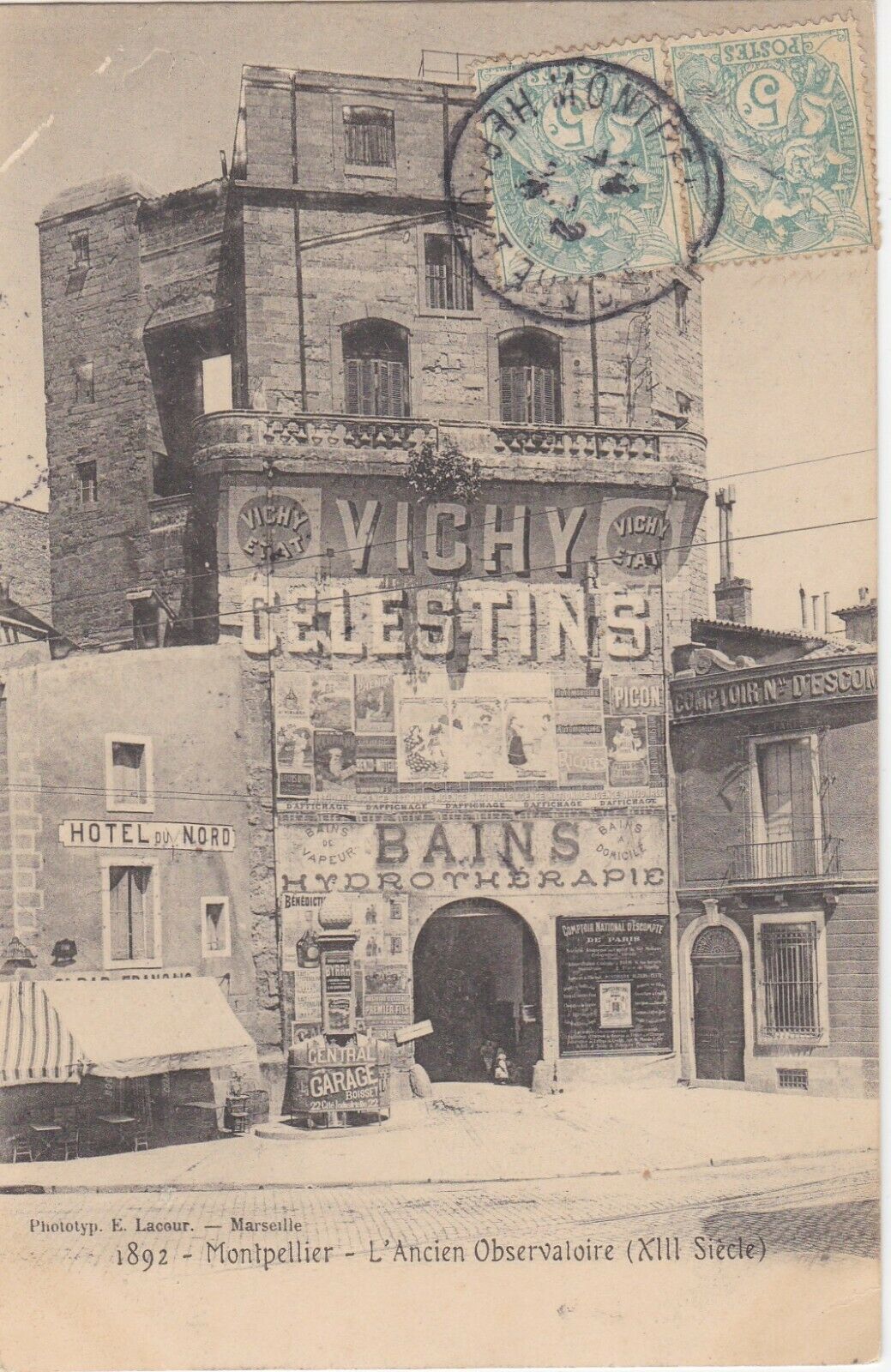Chaptal est une personnalité phare de la société royale des sciences de Montpellier en cette fin du XVIIIe siècle. Originaire du Gévaudan, il fait ses études de médecine à Montpellier.
Un enseignement public de sciences est créé dans le cadre de la Société royale des sciences avec une chaire de chimie pour Chaptal. La société met à disposition une partie du rez-de-chaussée pour y établir un laboratoire de chimie et une salle de cours.
Après son mariage, Chaptal se trouve à la tête d’une fortune considérable. En 1782, il fonde la manufacture de produits chimiques de « La Paille », au sud-ouest de Montpellier. Ainsi le professeur de chimie de la société royale des sciences devient un industriel. Mais il ne perd pas de vue son laboratoire, sa recherche et son enseignement.
Son œuvre scientifique est considérable, toujours tournée vers les applications dans des domaines aussi divers que la médecine, la chimie, la géologie la botanique l’agriculture, l’hydrologie… Au total il écrit environ 70 mémoires et une trentaine de rapports scientifiques.
Ses ouvrages ont connu un succès énorme avec plusieurs éditions et des traductions en plusieurs langues. Chaptal est connu dans toute l’Europe et en Amérique du Nord.